Étiquettes
Anne Elodie Sorlin, Caroline Binder, Céline Furher, Chiens de Navarre, Jean-Christtophe Meurisse, Jean-Luc Vincent, Manu Laskar, Maxence Tual, Thomas Scimeca
Nous avons les machines, le dernier opus des Chiens de Navarre, emmené par Jean-Christophe Meurisse, a été créé à la MAC de Créteil, a été joué au centre Pompidou (1er / 4 février 2012), au le festival Artdanthé au théâtre de Vanves (8 & 9 février) et est programmé au théâtre de Gennevilliers du 6 au 12 avril 2012). Avec Caroline Binder, Céline Furher, Robert Hatisi, Manu Laskar, Thomas Scimeca, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual et Jean-Luc Vincent.
DANS LA SOCIÉTÉ INTERGALACTIQUE
DE DEMAIN, QUELLE PLACE POUR L’ARTISTE ?
Il y a rire et rire. Rire gras et rire fou. Il y a le rire des comiques professionnels, et celui qui va de Feydeau à Thomas Bernhard, pour les modernes. Il y a la blague complice où tout le monde de rire du clin d’oeil lancé par la bête de scène (avec souvent en ligne de mire le ridicule d’un bouc émissaire de plus) et il y a un vertige de la pensée qui, se découvrant, attaque littéralement l’esprit et déclenche ce rire qui éclate tel un orage, en trombes de hoquets pas loin des larmes – trop c’est trop. C’est dans cette seconde topique du rire que se situe Nous avons les machines des Chiens de Navarre, même s’il reste possible de se croire dans la première.
Un vertige de la pensée, donc. C’est beaucoup plus sérieux qu’il n’y paraît, même si cela nous chope par le sensible et ne nous laisse guère le temps d’errer dans nos pensées sur le moment.
Ces « chiens » de Navarre… ils mordent ! Et certains spectateurs rient jaune ou moins qu’à leurs précédents opus, celui-là étant plus retors, si j’ose dire, ou moins évident. Cette horde particulière emmenée par Jean-Christophe Meurisse depuis quelques années maintenant (2005) suit le même fil coupant pourtant, d’opus en opus, ce fil d’une critique d’un certain état de froideur de la sensibilité générale. Par leur poétique, ils sont de la famille de Philippe Quesnes qui part de l’impossibilité de jouer aujourd’hui, et par leur politique, ils sont des alliés d’Eléonore Weber & Patricia Allio qui posent très différemment la même question de la perte de sensibilité et de la perte de la pensée donc, alors même que l’usage de coussins péteurs ou de masques hideux (qui sont inspirés par l’oeuvre du photographe Eugène Meatyard), ainsi que d’un certain grand-guignol, semblerait les rapprocher de Xavier Boussiron & Sophie Lenoir. Mais ils sont plus éloignés de la complaisance de ces derniers à se contrefoutre de tout qu’ils ne sont proches de L’effet de Serge de Philippe Quenes (où faire du théâtre devient offrir une petite soirée gentille, avec quelques brefs jeux visuels de fortune, à des amis étouffés, incapables d’articuler une parole, le théâtre devenant l’occasion de boire des coups, ce qui regarde de près des spectateurs d’aujourd’hui) ou de La Mélancolie des Dragons (qui promettait la transformation du festival d’Avignon en parc Anthonin Artaud par exemple). Ces remarques ne sont pas pour dire que Les Chiens de Navarre se limitent à un débat de formes, mais suggèrent qu’ils sont moins « marrants » qu’ils n’y paraissent.
Tout est dans leur principe de création et de représentation qui est l’improvisation, en contradiction avec un travail de mise en scène (Jean-Christophe) très directif ou disons une force de pensée issues de grandes discussions internes au collectif, sur ce qu’ils trament [possible ici de lire mon article paru dans mouvement.net en 2009, en ligne sur le site des chiens de Navarre]. Si le canevas est chaque fois très précis, il reste de larges plages de liberté aux acteurs, qui sont, pour Jean-Christophe Meurisse, d’abord des auteurs. C’est un moyen pour que l’acteur ne soit pas une machine, justement. Qu’il reste dans cet état excitant, de frôler le trou noir, le néant, ou de rentrer subitement dans sa fantasmagorie intime, de partir « en live »… Et il ne peut atteindre cet état que s’il sait pourquoi il est sur le plateau, pourquoi il joue plutôt que d’écrire un pamphlet sur le monde par exemple – ce que certains acteurs des Chiens de Navarre ayant un parcours universitaire pourrait savoir faire – et pourquoi il fait ce genre de théâtre d’écriture proche de la performance et non pas un théâtre de mise en scène de texte (d’interprétation). Bref, l’acteur des Chiens de Navarre vient d’une certaine colère de la pensée. Peut-être cette pensée n’est-elle pas le bout du monde mais l’important est qu’elle passe par un certain refus. C’est comme ça que quelque chose du péril de vivre traverse la séparation scène / salle, et, même si le spectateur n’est pas au parfum et trouve le texte particulièrement bien écrit, il ne pourra que sentir quelque chose de ce face-à-face de l’acteur avec le désastre du monde ou du théâtre, bref avec une pensée qui ne peut pas forcément se formuler comme ça mais qui est un refus de tout confort en ce domaine.
Par rapport aux précédents opus dont Une raclette est le plus notoire, Nous avons les machine est plus nu. Une raclette partait d’une critique de l’imbécillité petite-bourgeoise (se faire des dîners entre amis où rien ne se dit dans une conversation qui passe du coq à l’âne et où en même temps, les pires horreurs y passent en contrebande), pour faire une critique du théâtre qui critique ça. Une critique d’un théâtre que je dirais social-démocrate et dont le principe est de montrer au public certaines choses qui vont l’amener à « réfléchir » sans trop l’atteindre, voire qui vont l’émouvoir pour lui prouver qu’il n’est pas un monstrueux clinicien. La critique passait par l’improvisation, par des échappées folles, un emballement des acteurs. Dans Nous avons les machines, il y a encore ça. Après qu’Anne-Elodie Sorlin et Maxence Tual aient accueilli le public, cul nu et portant des masques hideux, jouant de coussins péteurs, arrivent une bande d’acteurs sérieux qui s’assied autour d’une table, et dont on comprend très vite qu’ils vont représenter une réunion d’opérateurs socioculturels dans une mairie. Des opérateurs dont l’activité est de secourir ces pauvres gens qui n’ont pas de place dans la société ou dans le monde (on a une représentante d’une association d’aide à un pays africain, cette association changeant à chaque représentation de nom et d’activité). Sauf que la réunion représentée, aussi comique soit-elle tant la stupidité de ce milieu est épinglée, notamment sa désincarnation et son langage rationaliste étouffant toute pensée, tout sensible, dérape brutalement. La plus clean des opératrices, celle qui oeuvre « pour » l’Afrique, sorte de Rachida Dati en Marilyn, se lève, attrape sa chaise et en frappe le plateau. Les autres acteurs sortent alors de leur petit jeu et s’y mettent tous, en une scène ambivalente. La chaise de bureau, symbole de cette place sociale vitale à avoir, subit une destruction totale. Et ce que l’on voit, c’est que si l’on veut détruire cette société dont nous subissons, impuissants, les progrès mortifères et déshumanisants, eh bien, ce ne sera pas demain la veille. A mains nues, même une chaise de bureau demande beaucoup d’énergie pour être anéantie. Que les acteurs glissent en improvisation dans une caricature un peu appuyée d’Américains grunge bonnet sur la tête et langage sommaire, dont la pensée se résume au slogan très profond de « fuck », dit assez bien quelle révolte dérisoire peut être la nôtre.
De drôles de petits hélicoptères téléguidés comme des drônes, survolent les spectateurs, pendant que dans un bidon flambe la chaise sacrifiée. Quelque chose d’inquiétant, qui peut raconter la fin de la planète Terre après une guerre particulièrement mondialisée et horrible. Un gros ballon bleu descend à la verticale des flammes et explose (comme dans Mélancholia de Lars Van Trier, sauf que c’est à l’inverse, presque une critique de cette idée de la disparition de la terre ou en tout cas du tragique que le cinéaste y attachait, étant donné qu’ici, la sphère bleue se réduit à un ballon vide qui éclate comme une bulle. Bulle spéculative des humains sur leur pouvoir technologique ?)
A partir de la chaise, le délire commence, un délire d’image, d’animaux images se poursuivant, d’images sauvages qui traversent les acteurs qui sont là comme des chamans, ou des revenants. Les mêmes sont toujours là autour de la même table, mille ans, deux mille ans ou trois cent mille ans plus tard, en petits hommes verts – un concept qui était propre aux années 70 – 80 et qui a complètement disparu depuis les progrès ahurissants de technologie qui en sont au clone et au cyberborg (l’armée américaine étant en pointe sur ce dernier produit). Et ils débattent des mêmes fausses questions, la culture et le théâtre n’ayant toujours qu’une place annexe, ici on ouvre désormais un centre Concordia (« la paix », le consensus) avec 150000 boutiques et quatre musées d’art contemporains et des dizaines de salles de spectacle… A quoi bon, le théâtre, quand les humains ont été remplacés par des clones, des cyberborg, des créatures bioniques et autres avatars insensibles de science-fiction à deux balles ou à la Philip K. Dick ? C’est avec mes yeux d’enfants qui a connu la guerre froide, l’angoisse des OVNI et des martiens, ainsi que la menace de la destruction nucléaire totale du monde, que je vois ça, c’est avec cet âme inquiète de l’enfant désarmé que Jean-Christophe Meurisse affronte en léger décalage cette menace de mondialisation de la destruction qui, aujourd’hui, paraît à la fois courue et à relativiser puisque nous aurions les machines. Cette satire d’un monde futur où on irait vivre sur d’autres planètes est plus une métaphore de ce décalage que Günther Anders a souligné entre la démesure de la puissance technologique et la mesure de la sensibilité humaine, Günther Anders évoquant L’Obsolescence de l’homme (L’encyclopédie des nuisances, 2002) à compter de l’apparition de la bombe atomique. Comment ressentir ce qui n’est pas à la portée de notre imaginaire ? Alors, on imagine avec ces petits hommes verts et cette sciences-fiction qui engraisse un certain cinéma commerçant depuis des années, avec des fantasmes autrement dit. Cette idée de déménager dans l’espace est pourtant bien dans l’air, des scientifiques ayant récemment découvert des planètes où la vie serait possible. Preuve que ces individus cherchent ça et ne voient pas le problème d’une telle transhumance planétaire, ni celui de la rupture avec le monde maternel primitif (désir qui fait finalement le fond de tout rejet de « l’autre »). Ça tourne au film d’horreur américain avec ses zombies cannibales, force de maquillage, de sang en capsule (cette scène peut évoquer une critique des moyens esthétiques de Vincent Macaigne qui recourt massivement aux liquides colorés, mais avec un sérieux pesant)… Avec mes yeux d’enfants, donc avec ma sensibilité d’enfant qui ne sait pas grand chose mais qui sait tout (comme dirait l’enfant dans la pluie d’été de Duras), je vois ça et je ris. Il y a du jeu au travers de ces maquillages improbables et excessifs, de ces jeux de scène idiots pour jouer à l’hologramme ou au cyberborg, du jeu qui nous est injecté là, comme pour nous immuniser contre ce qui nous tétanise, ce réalisme assommant, cette croyance dans la technologie qui viendrait à bout de toutes nos énigmes. L’absence de sérieux du théâtre est finalement très sérieuse. Il s’agit de nous redonner le plaisir d’imaginer, de délirer même, de « partir » intérieurement.
[Là, un apparté. Au théâtre de Vanves, deux Italiens, Lino Musella et Paolo Mazzarelli présentait le 8 février en première partie Filiodiunbruttodio. A priori, leur esthétique pouvait laisser extérieur. Il y avait du costume, des jeux d’acteurs entrant dans des personnages, mais le propos était de parler d’une Italie ravagée sans rémission possible, ravagée notamment par une tyrannie télévisuelle abjecte où la téléréalité vend de vrais gens comme « authentiques » (estampillés « d’origine »), faisant implicitement des acteurs des « faux ». Un producteur avait repéré un pauvre gars particulièrement écorché pour son émission contre l’injustice et le malheur. Le réalisme ne fait en vérité qu’écraser la distance de soi à soi, tout le jeu et la possibilité de penser sur soi. Si l’on avait en tête que ces deux artistes venaient d’Italie et que faire du théâtre là-bas devenait très étrange… la petite scène à la En attendant Godot entre deux clochards récupérateurs qui ouvrait et clôturait la représentation avec ses accessoires et ses jeux de rôles, devenait non seulement adorablement désuète mais poignante, tout en nous redonnant une respiration, il y a des voies de traverse possibles, peut-être, oui, il fallait jouer même si ça peut parfois être pénible. ]
Le cannibalisme. Il y a eu cette pièce il y a quelques années de David Bobée, Cannibales qui évoquait l’étouffement de la vie, amputée de ses forces d’engagement, de pensée, et réduite à la satisfaction des besoins de confort. Même l’amour parfait s’était réalisé. C’est bien le problème du sensible qui se pose, dès qu’il est question de cannibalisme contemporain (et non celui propre à des sociétés rituelles et dites primitives). C’est la question de toucher. Comment toucher. Est-ce que toucher l’autre c’est mettre la main dessus ? Est-ce que faire l’amour c’est se jeter sur l’autre et le consommer, voire le dévorer ou l’enduire de yaourt pour le lécher ? Je laisse cela en suspens. La dernière image est celle d’un écorché. Maxence Tual, tout nu, le corps pesant, patinant sur la table de réunion dans son sang de théâtre, se voit interrogé par une enquêtrice qui fait un sondage marketing pour une marque de yaourt. Celui qui vient d’avoir été symboliquement bouffé, se voit interrogé sur ce qui l’excite dans l’ingestion d’un yaourt. Il ne répond que d’une voix étouffée, un peu comme les invités de Philippe Quenes dans L’effet de Serge. Il se cache le visage, se recroqueville, il ne sait plus comment se mettre, la honte, là, le prive de toute parole.
Nous avons les machines, ça fait rire, parce que c’est ambivalent. Tout le monde quelque part se rêve en machine, capable de parler avec précision, d’agir avec efficacité, avec un temps d’avance pour prévoir les coups de l’adversité, et bien peu croient au mystère des choses, par rejet de tout le bric-à-brac philosophico-religieux qui galvaude cela. Et en même temps, ça rêve aussi d’être authentique, de brûler avec ses larmes et son sang… C’est dit au début dans l’interpellation au public. « Vous croyez que nous les acteurs on travaille sans se torturer ? Regardez, voici le bidon où on a recueilli nos larmes pour créer ça, et notre vrai sang qu’on a donné… » C’est la critique de tout un théâtre où l’acteur doit jouer avec ses tripes, se donner même pour faire vivre des personnages… Dans les Chiens de Navarre, il faut être aveugle pour croire en des personnages. Ce sont les acteurs qui jouent, qui sont eux-mêmes mais dans cet écart de la pensée, que seul un quant-à-soi maintient. Pour ressentir, il faut sentir puis revenir sur cela, une seconde fois. Il faut une mémoire, qui n’est pas machinique, qui peut dériver dans le fantasme. Il faut une enfance. Il faut du jeu.
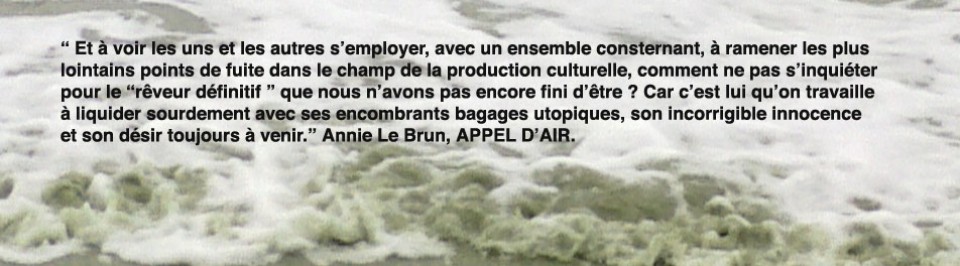




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.