Malaise dans la culture
« De la part de la culture, la tendance à restreindre la vie sexuelle n’est pas moins nette que l’autre consistant à étendre la sphère de la culture » Freud, Malaise dans la culture (PUF, Quadrige, p.46)
Sibérie. Incroyable film. Glaçant comme son titre. Incroyable pari. Des caméras numériques. Pas d’équipe son, lumière, pas de chef opérateur, pas de maquilleuse, etc., bref rien de ce qui fait le « cinéma ». Et à commencer pas de plateau. C’est dans un voyage en train à travers la Sibérie que le film est tourné, à l’avenant – ou presque, étant donné le pedigree (si j’ose dire) des deux acteurs & réalisateurs. Joana Preiss, actrice et aussi muse pour plusieurs artistes, chanteuse rock, et Bruno Dumont, réalisateur qui n’est pas à présenter, partent avec des caméras numériques filmer la fin de leur amour. Ou disons, qu’ayant acté l’un et l’autre que leur histoire finissait, ils ont décidé de la conclure par un acte artistique commun. Sur le même sujet, on a déjà vu Marina Abramovic parcourir la Muraille de Chine avec l’homme aimé dont elle se séparait. Là, il y a quand même ce fait qu’ils se sont rencontrés en Sibérie, certainement de façon improbable (je vais y revenir) et qu’ils décident de clore leur désir en repassant par ce point d’origine. Conscients sans nul doute de l’aspect stoïque de leur démarche – peut-on jamais clore un désir, surtout quand, ainsi que le film le révèle, il n’a pas pu aller au bout ? C’est d’ailleurs le sujet de Sibérie, ce désir glacé dès le départ. Nul besoin de connaître leur histoire personnelle, il suffit de lire le film. C’est bien, de ce point de vue, Joana Preiss qui signe le film. Bruno Dumont s’est en somme laissé embarquer même si j’ai cru comprendre qu’il aurait pu lui souffler l’idée, mais ce n’est pas forcément un don chrétien jusque dans la démarche cinématographique à laquelle il sacrifie, à l’inverse de la sienne (la caméra numérique, le temps réel, l’absence de scénario en apparence, l’exposition de lui-même, etc.).
Puissance désirante abîmée. J’ai hésité à écrire ce que j’avais vu, parce que c’était paradoxal. C’était à la fois un film de désir et un film qui rendait crû son absence. Je n’ai pas cru à l’histoire entre Joana Preiss et Bruno Dumont. Et tout d’abord, sans doute dérangée par ce qui dès le départ rend crûment une facticité amoureuse que seule l’on ne peut dire ne pas avoir connu sans mauvaise foi, j’ai pensé « film narcissique relatant un rien entre deux incapables ». La brutalité du regard d’un spectateur heurté par une représentation sans honte du narcissisme dont il ne peut sans rire s’estimer exempt, est parfois cinglante. Mais je suis restée et le film m’est apparu d’une justesse implacable, et d’abord dans son sujet. Pointant comment dans le milieu des artistes – et plus précisément cinématographiques -, milieu très occidental, la puissance désirante y est pervertis ou abîmée. Sibérie met à nu comme une infirmité de l’être de culture à désirer (aimer). Il y a un problème avec la sauvagerie sexuelle chez les « cultureux » (pas seulement chez eux) alors même que leur sujet, leur passion, pour beaucoup, a pour objet les énigmes du désir et de l’amour. Oui, problème d’autant plus que l’on pourrait s’attendre à ce que les artistes qui ont des natures d’acteurs, c’est-à-dire qui connaissent les questions qui accompagnent la mise en jeu de soi et qui savent être vrais tout en étant toujours en avant d’eux-mêmes, dans une forme d’expérimentation d’eux-mêmes, soient plus armés pour aller au-delà de leurs marques dans le désir et exorciser la glaciation. Mais non. Or, dans Sibérie, Joanoa Preiss dispose dispose les indices comme autant de petits cailloux dans une forêt qui semblent permettre de décrypter cet empêchement culturel à aller l’un vers l’autre, quand on est de la même « partie ».
Un jeu de piste. Sibérie c’est un montage de fou d’abord (montage signé Joana Preiss et Clémence Diart). A partir des rushes (plus de 24 heures), il construit une narration qui n’épouse pas celle du voyage. D’ailleurs, je n’ai pas bien compris s’il partait de l’Ouest vers l’Est ou vice-versa ; aux derniers plans j’ai pensé l’inverse, que Joana Preiss et Bruno Dumont retournaient vers l’Occident. Le film agit de nous amener dans ce renversement – dans ce trouble dont la solution m’intéresse peu -, qui nous parle de cette puissance du désir amoureux à nous faire quitter l’espace-temps réaliste, voire à inverser le cours des choses. Aussi, le début du film laisse encore imaginer que tout reste possible entre les amants, parce qu’ils se donnent un temps pour eux qui demeure gros de possibles, de jaillissements imprévisibles. Il va vers l’orient qui est l’altérité de l’occident. Mais à la fin, le spectateur sent la fin irrémédiable et éprouve la sensation « de prendre la direction de la maison », que l’Ouest symbolise pour des Occidentaux. Il reste un voyage hors du temps (à côté du voyage réel) qui est rendu dans le montage, plan après plan, par une captation de l’intime, qui définit ce qui est très proche de soi. Les plans restituent la perception sensible des choses, par nature flottante ou fugitive, d’où la brièveté de nombre de plans – un fragment de corps, de conversation, de paysage. Cela donne au film une force, celle de capter les choses à l’endroit où elles vont faire traces. En cela, Sibérie est un film sur la mémoire, un film qui représente comment la mémoire s’entre-tisse de sensations sensorielles, et, donc, un film de désir, ou puisque c’est le désir projeté sur les choses qui les rend mémorables. Cela donne aussi au final l’impression d’une mosaïque de plans qui parlent de quelque chose qui ne se raccorde jamais, d’un heurt incessant, d’une coupure sans cesse déplacée.
Impossibilité amoureuse. L’apparition progressive de l’impossibilité amoureuse entre ces deux belles personnes s’offre au regard, s’expose. Ni l’un ni l’autre, à ce qu’il semble à mesure que le film avance, n’ont peu sortir du malentendu, de ce malentendu qui est lié à la différence sexuelle. Se rencontrant en Sibérie, ils ont pu se raconter que quelque chose de merveilleux leur arrivait. C’étaient en effet des circonstances qui peuvent évoquer un destin amoureux singulier. En Sibérie, Joana Preiss rencontre un réalisateur qui fait des films où la femme n’a pas la position d’un objet érotique et où cependant l’érotisme est « courant » d’image en image. Elle qui a été trop souvent réduite au statut d’icône ou d’égérie au bras d’artistes connus, elle Qu’a-t-il vu d’elle ? ? C’est ce qu’elle interroge tout au long du film. Joana Preiss est une belle femme, mais parce que c’est un monstre de désir ; dont la beauté n’a pas forcément été reconnue pour ce qu’elle été, celle d’un monstre de désir avec tout le merveilleux que cela veut dire, a pu espérer rencontrer quelqu’un qui l’aimerait pour ce qu’elle est. Toute la question est de savoir ce que Bruno Dumont aurait vu en elle ? C’est cela ce que Joana Preiss interroge, tout en ayant déjà la réponse, qui est dans la rupture. Bruno Dumont l’aura déçue. Il n’aura vu en elle qu’une belle femme touchante. C’est dans le film, dans les images qu’il prend d’elle, dans son dégoût d’elle quand elle est soûle (mais la douleur de ne pouvoir être entendue peut faire boire) ; dans son désir exprimé de la toucher sexuellement et seulement sexuellement – car s’il dit qu’elle le touche, que fait-il, lui, pour la toucher ? Où en est-il avec son érotisme ? comment désire-t-il ? que désire-t-il ? Comment son émotion amoureuse s’articule-t-elle à son émotion sexuelle ? Joana Preiss face à cela ne trouve rien de mieux qu’à dire que l’amour peut se passer de sexe. En plein 2012 où le kitsch traditionaliste gagne minute après minute du terrain, la voir, elle, dire ça, on se frotte les yeux. C’est ce contentieux qui est là, disséqué, dans Sibérie, sur fond de paysages russes dévastés par la mondialisation. Mais à ce niveau du problème, le monde devient secondaire. C’est une vraie fin de recevoir mutuelle et réciproque. Joana Preiss travaille à être émue par la pensée d’un cinéaste qui porte une vision. Elle l’est mais dans le fond, mais elle rêve aussi d’un vrai gars comme l’un de ceux croisés sur un banc qui lui offre de la vodka. Alors qu’elle a affirmé que le sexe n’y suffisait pas.
Le don de Bruno Dumont. Le réalisateur s’est donné, s’exposant dans son intimité la moins avouable, à Joana Preiss pour qu’elle puisse dire cela qui regarde bien au-delà d’eux. Il accepte de se montrer avoir été incapable de l’aimer en tant qu’elle est elle, ou d’ouvrir une brèche dans ce malaise dans la civilisation ou la culture. On sent même chez lui une manière rétrograde de voir le couple : il voulait qu’elle vive avec lui ; il n’aime pas qu’elle boive. Elle finit par lui faire dire que son trip, ce serait d’avoir une femme à lui, bien à lui, pour qui il serait tout. Ce qu’il reconnaît, comme en effet le fond archaïque de son désir. Cela contre toute attente, Bruno Dumont dont le mobile reçoit des appels téléphoniques, l’ancrant dans sa position de cinéaste reconnu, jusqu’à la scène où il est reçu dans un cinéma russe comme personnalité avec tous les honneurs, n’a rien ‘archaïque ; il est mondialisé et exempt de la pauvreté de langage qui fait un homme brut. Il y a une certaine perversion chez lui . Mais aussi chez Joana Preiss. Joana Preiss loin de dissimuler ce malaise, lui donne toute sa visibilité, telle une critique au vitriol du monde culturel, dans son impuissance à répondre du désir.
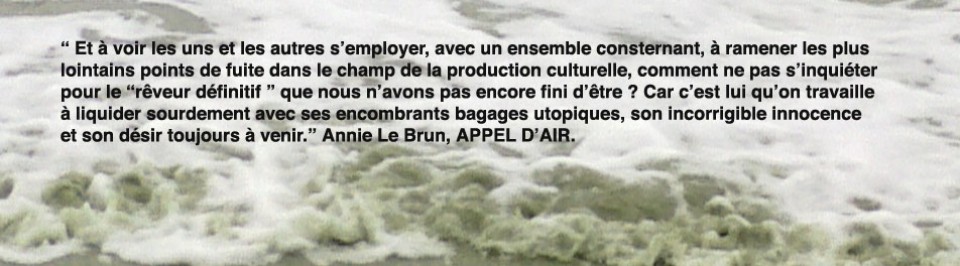




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.