Étiquettes
Alice Winocour, Augustine film, Charcot, Dharamsala, Salpêtrière, SoKo, Vincent Lindon
De quelle cauchemar la femme s’éveille, si tant est…
Mange ta soupe, tu guériras. Dit Charcot (Vincent Lindon) à sa jeune patiente, arrivée après une crise violente chez ses maîtres, en pleine réception après qu’un invité l’ait regardé avec comme qui dirait un désir auquel elle n’était pas étrangère, d’où elle ressort avec un oeil refusant de s’ouvrir. Ça lui donne l’air de faire un clin d’oeil permanent. Au cours de son séjour, elle l’échange contre une contracture au bras ramenant sa main sur son sein. Allez, mange. Et il la nourrit à la cuillère, d’une soupe qu’il a goûtée chrétiennement. La « soigne ». C’est le regard d’un père aimant. Il était parti sans l’en avertir, elle avait dépéri. Et c’est déjà un transfert qui s’opère avant l’heure freudienne. La jeune patiente, c’est Augustine (Soko), le rôle titre du film d’Alice Winocour.
En toile de fond, l’histoire naissante de la psychiatrie moderne et qui annonce celle de la psychanalyse. On est en 1882 quand Jean-Martin Charcot (1825-93) « invente » l’hystérie comme en fait l’hypothèse Georges Didi-Huberman dans L’invention de l’hystérie (Ed. Macula, 1982). Il sera reçu à l’Académie des Sciences – c’est la fin du film, où grâce à une très belle crise d’Augustine alors même qu’elle est factice, il souffle l’assistance – et le début de sa notoriété. La suite, on la connaît : Un jeune étudiant juif autrichien qui va devenir très célèbre assiste à ses leçons (1885-1886) de plus en plus courues. On se presse pour voir ces femmes du peuple qui semblent grosses de tremblements de terre charnels oubliés. Plus de quatre mille s’entassent à La Salpêtrière. Lieu relativement infernal, ce fut le premier hôpital général construit au moment du « grand renfermement » décrété par Louis XIV et qui, dès l’origine, fut une maison de correction et non un « hôpital ». Spécialisé dans les femmes. Dès l’ouverture, plus de trois milles enfermées et enchaînées pour certaines – ce qui était énorme vu la population parisienne à l’époque. Leurs crimes ? Mendiantes, putains, épileptiques, ou un peu énervées.
Pour Charcot, il s’agit moins de soigner que de repérer une maladie unique à travers des symptômes variés et dissemblables, pire : en l’absence de lésions organiques. Avec l’assistance de photographes, devant lesquels les patientes, hypnotisées, rejouent leurs crises en somnambules, Charcot inventorie les cas. Il en reste des clichés où des femmes en convulsions semblent au bord d’une extase à la Sainte Thérèse, et d’autres où leur stupeur semble invétérée, sans parler de monstruosités effrayantes. La Salpêtrière est pour Charcot « un musée pathologique vivant » (L’invention de l’hystérie, p. 20). Les patientes étaient aussi les cobayes de thérapeutiques douteuses, à base d’électricité ou de magnétisme, souvent orthopédiques (toujours cette idée du redressement, de la correction). Il y en a une expression dans le film d’Alice Winocour : on voit Charcot content d’avoir fait fabriqué un joli appareil d’étouffement pour Augustine. Le jeune étudiant juif autrichien qui va devenir très célèbre pressent que la maladie n’est pas organique mais affecte la psyché. Ce n’est pas en modelant le corps qu’on y changera quelque chose. Et il devient Freud. Les femmes de la Salpêtrière, considérées jusqu’à la Révolution comme des délinquantes, puis des malades avec Charcot (« hystériques »), accéderont à la dignité de sujet. L’hystérie, je le rappelle, frappe le corps interdit de parole et considéré comme objet dans son histoire subjective mais aussi collective, il se met donc à parler physiquement. La femme, encore aujourd’hui, combien souvent est-elle suspectée d’hystérie à la moindre de ses colères ? Et ainsi culpabilisée de prendre parole ? Mais avant Freud, donc, Charcot. Et dans ce film d’Alice Winocour; romancé, comment il est au bord de la découverte de l’inconscient, épiant une nuit Augustine parlant dans son sommeil, comme aussi, l’ai-je dit, intuitivement, crée-t-il un transfert qui permet à cette dernière de se reconstituer comme sujet de parole et de désir.

Du romanesque. De l’enfer que fut la Salpêtrière, Alice Winocour fait un site plus imaginaire que réel, à caractère romantique – au sens de l’histoire d’un mouvement de pensée esthétique et philosophique, et non au sens commun du cinéma actuel dont Titanic ou La route de Madison sont des exemples. Des contreforts envahis de végétations grimpantes – improbables à la Salpêtrière située en plaine -, des linges étendus comme à la campagne, des jardins à la française défeuillés l’hiver, campent le paysage d’une nature à l’abandon, vide, à la manière d’un tableau de Friedrich Caspar David (qui est d’une époque antérieure à celle du film), sur lesquels se découpent en quelques rares plans saisissants les silhouettes de Charcot et d’Augustine en promenade. Inquiétante étrangeté de leur présence au monde, ici. Les accompagnant comme des ombres, en arrière-plan tout au long du film, un choeur de figurantes dont les visages et les corps contemporains, marqués, témoignent d’une souffrance psychique féminine toujours actuelle et abyssale. Ce choeur compte cinq choreutes qui sont à un moment filmées en plan fixe dans un insert rompant le fil narratif. Chacune relate brièvement son histoire, excepté l’une, âgée, qui expose son mutisme d’une manière bouleversante, accablante. Pour les autres, des scarifications à la crise mystique (l’une au Sacré-Choeur a interpellé des bonnes soeurs pour les appeler à se libérer), le sort a pris des dimensions aussi tragiques et sacrificielles, d’autant plus qu’elles disparaîtront sans laisser de traces. Ce sont des femmes du peuple qui ont eu accès par des voix sensibles extraordinaires à une douleur qui les sortent du rang humain. La bande sonore (Jocelyn Pook) ajoute une tonalité sciemment mélo, alors même que les génériques de début et de fin sont portés par la voix très douce de Soko, dans une couleur hyper mélancolique mais rock et actuelle. De même, le travail de la couleur de l’image, de la lumière, la prise de vue et le cadrage (Georges Lechaptois est le chef opérateur) compose le film comme une peinture romantique, où dominent des rouge, des bruns, des verts, des noirs, et des ombres, d’une manière qui associe aussi bien l’éloignement et la mise en perspective que l’intimité avec les choses et les corps. On est dans la problématique de l’aura, dans la dialectique entre le proche et le lointain. Les étoffes, les matières, les sombres, l’orage un soir où Charcot rentre chez lui sous des trombes d’eau, tout concourt non sans une imperceptible ironie bien romantique (justement) à faire vibrer cette chanterelle, de façon à instaurer une distance un brin spirituelle tout en nous plongeant dans le maelström du continent féminin. En fait, le pathos volontairement romanesque qu’Alice Winocour donne à son film, un film à costumes au caractère a priori historique (les costumes sont vintage et les décors soignés pour être crédibles ), sert paradoxalement à démentir tout naturalisme, réalisme voire psychologisme (ce n’est pas l’histoire d’Augustine) pour rendre sensible sa portée symbolique et contemporaine. Un peu comme dans l’esprit fin de siècle, le roman noir servit de contrepoint au réalisme progressiste pour rappeler ce « bloc de noir », dont Annie Le Brun dans Les châteaux de la subversion (Jean-Jacques Pauvert, 1982), rappelle la persistance humaine, comme dans nombre de ses livres :
« Critique inavouée, inavouable de ce qui se fait et se dit alors ? Peut-être, mais pas seulement, les chemins de l’imaginaire sont plus imprévisible (…). A d’autres la commodité de penser que le roman noir ne serait que le refoulé du siècle des Lumières. Au contraire, lieu mental que s’est trouvé et choisi cette époque-là, il constitue sans doute la première tentative (…) pour éclaircir une nuit dont nous ne sommes pas sortis. Nuit sensible, mentale mais aussi nuit morale. » (Folio essais 31, p. 13).
Augustine n’est pas un film sur la Salpêtrière, ni sur Augustine mais, à travers la métamorphose de cette dernière, sur un monde désenchanté où balbutie le moi féminin. A travers aussi une prise de vue très rapprochée sur les corps sur l’assomption de l’intime, par lequel le féminin se définit, c’est-à-dire sur ce rapport hyper hyper sensible à son propre corps qui se passe de la représentation ou de l’image de soi.
Métamorphose par la transgression.

Friedrich Caspar David (The Rocks Gates in Neurathen)
Augustine va séduire, et baiser (il n’y pas d’autres termes) Charcot, franchissant interdits sociaux et tabous sacrés. Avec Charcot, elle se rachète du bel invité bourgeois qui avait déclenché la crise initiatique ; elle flirte avec l’inceste, Charcot ayant non seulement l’âge d’un père mais aussi sa place symbolique dans le transfert instinctivement orchestré par ses soins et inspiré par un amour qu’il découvre à mesure qu’il le vit ; enfin elle touche à un grand Manitou, à un patron, une autorité, un maître. Mais pour arriver à ce point de retour, à cette passe dont elle ressort libre, il lui faut tenter de fuir et d’échapper au désir qui la lie à Charcot comme à l’impression d’être une bête de foire. La voilà qui prend la tangente dans une séance d’habillage la préparant à sa comparution publique pour l’audition de Charcot à l’Académie. Le froissement d’un satin bleu roi pris dans la fuite à toutes jambes de cette fille de rien, un plan à la Godard (dans Sauve qui peut la vie, 1980, ma référence se rappelle ici très bien du sujet de ce film), traînées abstraites de couleurs emmêlées, pur tableau filmique, sur les jupes cossues. C’est dans les jambes que ça se passe, c’est là que le corps reprend possession de lui-même, la course force à respirer. Augustine n’est pas une patiente ordinaire, elle a la révolte dans le sang, mais voilà elle chute. Revient à elle, regarde le ciel, le vent dans les arbres et puis réalise qu’elle a récupéré son bras et sa main.
Augustine a existé. Elle a été photographiée (on la voit dans L’invention de l’hystérie), le visage enfantin et une détermination dans le regard. Elle a été une préférée. On sait une chose, c’est qu’elle s’est enfui de la Salpêtrière.
Augustine vient mais pour objecter sa toute récente prise de conscience. L’hypnose ne prend pas. Charcot, inquiet, se charge alors de l’hypnotiser lui-même ; alors qu’elle entre dans son regard, le désir resurgit, et elle se fait actrice pour lui rendre le service de jouer une belle crise. C’est l’intelligence de Soko de donner à ce moment, par rapport aux autres crises qu’elle a jouées, une dimension imperceptiblement factrice pour rendre sensible qu’elle joue pour Charcot – elle lui murmure juste avant qu’elle est guérie -, là où dans des scènes précédentes, elle jouait une jeune femme qui ne jouait pas, nous bouleversant par sa puissance évocatrice. Et elle joue son désir pour Charcot, se dénudant même les seins. Tout ce qui a été dit sur la femme actrice, factice, séductrice, trouve ici sa réponse : la femme se tire d’un guêpier où l’homme l’a fourré, avec des armes d’artiste. Et ses armes sont celles de la mémoire de son sensible. Si Augustine peut faire illusion à l’aéropage de scientifiques venus l’observer, c’est qu’elle peut puiser dans sa mémoire de la douleur qu’elle a traversée, tout en restant à distance. Sa prestation laisse pantoise l’assistance. Charcot la renvoie dans son bureau et la rejoint. Et elle lui prend la main, l’emmène dans son sexe. Puis, et c’est ça le plus intéressant, après l’acte, elle se rhabille sans mot et s’en va. Charcot la voit disparaître vêtue d’une cape noire parmi la foule mondaine. Un plan romantique, imaginaire, s’insert. Augustine courant dans un jardin à la française vide et désolé. Vite recoupé par un autre où elle marche dans la rue, libre, le regard sombre, secret, lourd.
Un regard masculin enfermant la femme, refusant son altérité. Il faut le dire, d’où la femme vient. Du cauchemar masculin dans laquelle elle est enchaînée (comme étaient enchaînées certaines prisonnières de la Salpêtrière avant la Révolution). Du fantasme masculin qui la rêve, l’hallucine ou l’idolâtre ; qui la transforme en créature fantastique, à demi diabolique. Quand elle n’était pas « bien née », elle était vue entre l’animal et la demeurée. Animale, elle faisait moins peur à l’homme que demeurée. Charcot qui aime un gros chien ou qui agrémente son bureau d’un adorable singe, Zebidi, tente par ses travaux de se relier à l’altérité féminine mais quelque chose le retient de vraiment jeter un pont vers la psyché féminine, peut-être la peur d’y rencontre sa propre altérité, son propre lien à l’animal u sa propre bêtise ? Se laissant aller à jouer avec son singe et sa patiente, il réalise passer certaines bornes de la sensualité qui le rapproche du monde de l’enfance comme de l’animal. De même, dans un plan de dos, on le voit nu, Vincent Lindon lui prêtant une allure on ne peut plus fauve. L’inquiète plus encore cependant la débilité soupçonnée chez sa patiente. Pour elle qui semble ne pas savoir lire ou écrire (alors qu’elle dit avoir reçu des lettres d’amour), il est sans pitié. Cela me rappelle une scène poignante dans L’Apollonide de Bertrand Bonello (2011) où une prostituée, heureuse de s’être fait offrir un livre par un client plus aimé que d’autres, le lit et sombre en pleurs : c’est un livre scientifique qui s’appuie sur des mesures de crânes et d’autres stupidités de cet acabit pour prouver que la prostituée est d’une race d’handicapées mentales. Pour cet homme, elle ne serait jamais non seulement qu’un objet sexuel mais une bête. Ce serait se voiler la face que d’affirmer que toute trace de cet ancien monde masculin où l’on observait la femme comme derrière une vitre pour n’en être point contaminé a disparu – et négationniste de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Dans Augustine, même grande bourgeoise comme la femme de Charcot (à laquelle Chiara Mastrioanni donne toute sa classe), et même de condition supérieure à ce dernier (l’on comprend qu’elle intrigue par son relationnel pour le placer, lui l’obscur médecin aliéniste), sa condition reste particulière et elle n’est autorisée à exister que comme objet esthétique. Il y a cette scène lapidaire – et drôle – où, à table un soir, Charcot la complimente, alors qu’il ne lui adresse presque jamais la parole, sinon relativement à son ambition. Je vous trouve particulièrement belle ce soir, lui dit-il. Réponse : J’y ai passé la journée. En effet, tout est assorti, bijoux, tissus, maquillage, c’est un chef d’oeuvre, un tableau de maître vivant. Ainsi apparentée à une oeuvre d’art, la voici nettoyée de sa tache, de son animalité de naissance, et digne de se voir adresser la parole par ce grand bourgeois vieillissant qu’est Charcot, qui cependant semble avoir ensuite besoin de réflexion pour résoudre la remarque acide de son épouse. Cette énigme qu’est la femme, Charcot semble de façon inconsciente chercher à y répondre à mesure qu’il étudie, dessine des femmes convulsionnaires, observe et catalogue les sujets féminins. L’acte sexuel commis, Charcot semble choqué d’avoir non seulement désiré mais de s’être pris d’amour paternel pour Augustine, une petite bonne qui le touche, se rend-il compte, peut-être infiniment plus que l’esthétique de sa très belle épouse. Le regard hagard de Vincent Lindon, immédiatement repris, en dit long sur l’abîme qui vient de s’ouvrir et de se refermer peut-être aussi vite.
L’énigme du féminin. Pour suivre Augustine dans ses méandres, il faut regarder Soko. Cette dernière donne à son personnage sa morphologie singulière, unique en son genre, toute fine et en rondeurs en même temps, à rebours des canons actuels de la plastique. Aucune trace d’androgynie pour un visage marqué par l’enfance encore rayonnante. Une sensibilité éclatante qui imprime l’écran de ses milles pensées incessantes. Elle a tout pour intriguer le désir et le dérouter. Trop vivante, elle touche à chaque instant. La regardant, je me suis mise à voir l’uniformisation actuelle des physionomies féminines comme une implicite sélection naturelle atroce éliminant le corps trop féminin et avec, la sensibilité trop féminine. L’altérité féminine s’érodant, à mesure que la différence entre masculin et féminin est reniée. Connue très jeune pour ses chansons qu’elle a composées et chantées sans moyens, elle a voulu ce rôle. Dans la continuité de celui qu’elle a dans Bye Bye Blondie de Virgine Despentes, où elle joue Béatrice Dalle jeune punk, elle semble poussée par le désir d’affirmer quelque chose de la rébellion féminine. Et pourtant, elle joue presque en s’effaçant, sans orgueil d’actrice, laissant apparaître son personnage et, avec lui, le fil qu’Alice Winocour tisse. Augustine un film de femme sur le mystère féminin. 12 juillet 2012.
Note de l’auteur : Je précise que j’ai été figurante sur ce film pour six journées.
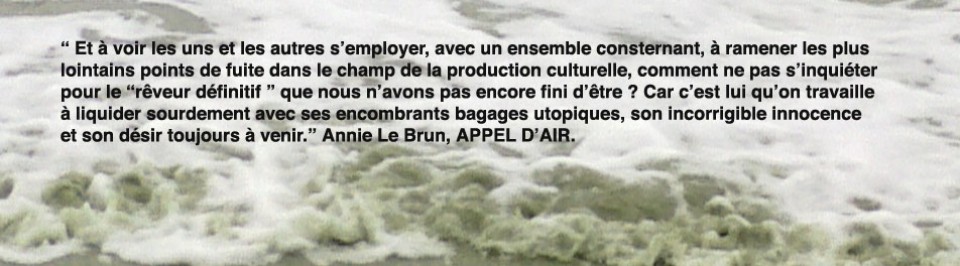





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.